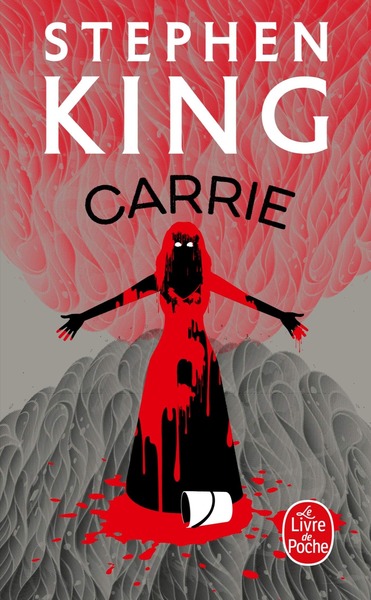
Stephen King : le boss de la littérature horrifique américaine occupe une place de choix au panthéon du fantastique made in USA avec E.A.Poe et Lovecraft. 350 millions de bouquins, Ça en tête ; des adaptations cinématographiques en pagaille ; une prolixité littéraire qui n’a d’égal que la qualité des romans produits. King est devenu incontournable. Sauf que dans l’Amérique de Trump, sa prose gêne. Parmi les livres mis à l’index par les bibliothèques des états les plus conservateurs : Carrie édité en … 1974.
Pas un hasard. Derrière ce roman d’horreur à succès — qui lança la carrière de King et inspira le film culte de Brian De Palma — se cache un texte d’une lucidité déchirante sur la cruauté sociale, la peur du féminin, la violence des normes, la démence fanatique. Qu’on le bannisse aujourd’hui avec tant de virulence n’a rien d’un hasard : c’est, au contraire, la preuve éclatante de sa puissance subversive. Et une invitation à lire/relire ce récit terrible à plus d’un titre et qui en dit sur une Amérique où il ne fait pas bon être différent.
L’horreur comme autopsie du réel
Carrie raconte l’histoire d’une gamine humiliée, enfermée dans la ferveur fanatique d’une mère malade de religion, rétrograde et frustrée au-delà du concevable. Persécutée par ses camarades, la petite vit en vase clos avec cette génitrice démente. Dans ce cocon mortifère, elle développe des pouvoirs télékinétiques que les troubles de l’adolescence vont exacerber. Victime de l’humiliation de trop, Carrie, mue par une colère aveugle, va déchaîner l’apocalypse dans un bal de fin d’année.
Ce déchaînement spectaculaire constitue l’aboutissement tragique d’une discrimination. Avant la catastrophe, King bâtit un laboratoire sociologique : une petite ville américaine moyenne, proprette et cruelle, saturée de puritanisme, où la différence devient une faute. L’horreur naît ici du collectif, de la normalité, de ce que King appelle “la conscience grégaire” — cette capacité du groupe à broyer l’individu au nom de la morale.
Carrie n’est pas un monstre : elle est une victime mue par une volonté de vengeance incontrôlable. Et dans cette bascule se joue tout le génie du roman : le monstre, c’est la société.
Un roman sur le corps et la honte
L’un des passages les plus célèbres — et les plus souvent censurés — demeure celui de la douche, quand Carrie, ignorant tout de la menstruation, saigne pour la première fois sous les rires de ses camarades. La scène d’une violence inouïe. King fait de ce moment une révélation symbolique : le corps féminin, porteur de vie, constitue un objet d’effroi et de dégoût. La peur du sang menstruel se mue en peur du pouvoir de la femme potentielle génitrice.
Dès lors, le roman s’écrit comme une parabole du féminin réprimé : Carrie est celle qui incarne la nature refusée, la puissance contenue, la sensualité diabolisée. Le geste final de l’héroïne, plus qu’une explosion meurtrière, constitue un exorcisme politique. Carrie prend possession de ce qu’on lui a confisqué : son corps, sa parole, sa puissance.
Une architecture polyphonique et moderne
Carrie adopte une structure éclatée, quasi journalistique : extraits de rapports officiels, témoignages, coupures de presse, fragments de livres postérieurs à la catastrophe alternent avec les focalisations internes pour animer le fil du récit.
King expérimente ici une forme hybride entre roman, reportage et étude de cas. Le fantastique devient procès-verbal du désastre humain, au croisement de la littérature et du document. Ce dispositif, inspiré autant de Faulkner que de Capote, donne au texte une dimension réflexive : il ne s’agit pas seulement de raconter, mais de comprendre comment un événement tragique devient mythe. Comment une fille humiliée devient une légende de peur, puis un objet d’étude.
Carrie, ou l’Amérique jugée par ses fantômes
Derrière la télékinésie, derrière la vengeance, il y a l’Amérique : ses églises étouffantes, ses lycées cruels, sa morale corsetée. Carrie incarne tout ce que cette Amérique ne veut pas voir : le désir féminin, la colère adolescente, la violence de la foi, la faillite du collectif. Le roman pose, dès 1974, les fondations d’une critique sociale et féministe qui parcourt toute l’œuvre de King.
C’est une fable sur le pouvoir nié des femmes, sur la rage de celles qu’on a réduites au silence.
Et c’est sans doute pour cela qu’il continue à déranger : Carrie expose l’hypocrisie du puritanisme, la toxicité du conformisme, l’érotisation de la punition. Il révèle la face cachée d’un ordre moral encore triomphant, qui peut aller jusqu’à l’infanticide (il suffit d’évoquer l’affaire Ruby Franke pour comprendre que cette position fanatique est réalité).
De la tragédie grecque au mythe américain
Sous le vernis du roman d’horreur, Carrie rejoue la mécanique antique de la tragédie : fatalité, hubris, catharsis. Comme Médée, Carrie tue et brûle, non par cruauté, mais parce qu’elle est poussée au-delà des limites humaines. Le feu purificateur n’est pas vengeance : il est justice métaphysique. King, dans un geste d’une rare intelligence, fait de cette adolescente martyrisée une figure christique inversée : celle qui, au lieu de mourir pour les péchés du monde, fait mourir le monde pour les siens.
Carrie demeure ainsi un roman majeur. Parce qu’il parle de nous — et pas seulement de nos monstres. Parce qu’il aborde la douleur du féminin, l’aveuglement religieux, la bêtise collective avec une justesse psychologique qui dépasse largement les codes du genre. Le fait qu’il soit banni des bibliothèques dans certains États américains — Texas, Mississippi, Utah — ne signe pas sa dangerosité, mais son actualité brûlante.
Interdire Carrie, c’est refuser de voir ce que le roman raconte : la peur viscérale d’une société patriarcale face à la puissance de celles qu’elle prétend protéger. C’est en cela que Carrie n’est pas un simple roman d’horreur : c’est une œuvre de littérature, au sens le plus noble du terme – celle qui dérange, éclaire, dénonce et transforme.
Et plus si affinités ?
Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?
Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?
