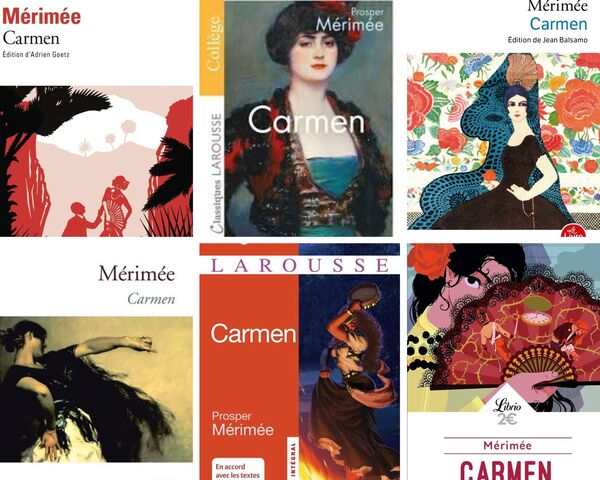
Carmen 150 ans : tandis que mes petites camarades s’escriment à décortiquer l’opéra de Bizet, je mets le pif dans la nouvelle de Mérimée. Parce qu’il faut bien l’admettre : sans la prose de Prosper, Georges n’aurait jamais accoucher de son opéra et nous serions contraints.es de vivre sans les arpèges de l’Andalousie la plus célèbre de l’art lytique mondial. Objectif donc du glissage de nez dans les pages de Carmen version livre : qu’est-ce que Bizet a piqué à Mérimée ? Et comment ?
Drame passionnel à l’espagnole
Avant d’être l’opéra le plus joué au monde, Carmen fut donc une nouvelle, publiée par Prosper Mérimée en 1845. Je passe sur le résumé (le récit est un brin tortueux), en soulignant cependant que l’intrigue développée par l’auteur s’étale sur plusieurs mois et suit le périple d’un archéologue français (le narrateur) qui croise la route de Carmen et Don José lors d’un voyage en Andalousie. C’est ainsi qu’il découvre le destin du contrebandier, ancien brigadier tombé dans la délinquance par amour pour cette gitane dont il est jaloux au point de la tuer avant de se rendre aux autorités.
Inspirée par un voyage en Espagne, cette histoire pour le moins passionnelle et violente propose un récit mêlant exotisme et romantisme avec en toile de fond un pays magnifié. Clairement, ici le personnage central, c’est Don José, Carmen se contentant d’être un objet de fascination aussi bien pour ce héros que pour le narrateur. Le regard porté sur Carmen est donc doublement masculin, et biaisé. Libre, insaisissable, séductrice, manipulatrice au besoin, Carmen est aussi, et surtout, observée, jugée, condamnée.
Observation ethnographique
Le texte, même s’il s’habille d’un ton documentaire, fonctionne comme une mise à distance : on ne comprend pas Carmen, on la désire ou on la craint. Elle est figure de l’Autre : gitane, dangereuse, sexuelle, irrécupérable. Elle se joue des hommes, elle manipule Don José, le pousse au crime. Mais ce n’est pas une héroïne tragique : c’est une criminelle, une voleuse, une sorcière presque. Mérimée s’intéresse moins à elle qu’à l’Espagne en tant qu’espace d’observation ethnographique.
Le livre regorge de notes sur les coutumes, de mots en espagnol, de digressions sur les mœurs, les croyances. Le tout baigne dans un parfum d’orientalisme : Carmen est un fantasme colonial. Or, ce n’est pas cette Carmen-là que l’on retrouve dans l’opéra. Car Bizet et ses librettistes (Henri Meilhac et Ludovic Halévy) procèdent à une transformation radicale du matériau littéraire. Dans l’opéra, Carmen prend la parole. Elle chante, elle revendique, elle s’affirme. Elle n’est plus seulement racontée : elle existe.
Une icône universelle
La musique lui donne corps, souffle, sensualité. La Habanera n’est pas qu’un air : c’est un manifeste. Carmen devient le centre de l’action, non plus sa victime ou son prétexte. La dimension ethnographique s’estompe au profit d’une dramaturgie concise, tendue, efficace. Bizet fait le choix du tragique, du désir et de la mort. Il ne juge pas ses personnages : il les laisse s’exprimer. Là où Mérimée dissèque, Bizet incarne. Il donne à Carmen une puissance scénique inédite, qui transformera l’imaginaire collectif.
En adaptant la nouvelle, Bizet ne trahit pas Mérimée : il l’éclipse. Il fait de Carmen une héroïne. Non pas une sainte, mais une femme libre, qui refuse d’être possédée. Une femme que la société ne peut contenir, et que la jalousie masculine détruit. Cette bascule est essentielle : elle explique pourquoi Carmen est devenue un mythe moderne, une figure féminine paradoxale, entre liberté et condamnation, entre force et destin.
Et plus si affinités ?
Vous avez des envies de culture ? Cet article vous a plu ?
Vous désirez soutenir l’action de The ARTchemists ?
